ÉPIDÉMIOLOGIE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE DE LA MORBIDITÉ EN ANESTHÉSIE

Contrairement à la mortalité liée à l'anesthésie qui, nous venons de le voir, est bien quantifiée, les documents à notre disposition concernant la morbidité sont moins abondants et moins précis en dépit de quelques belles études dont l'enquête française Inserm [64, 112, 135]. La première partie de ce paragraphe sera consacrée à l'estimation de la morbidité. Dans la deuxième partie, les grands types de complications seront envisagés en fonction de leurs facteurs.
Estimation de la morbidité
Trois sources d'informations sont à notre disposition :
quelques études épidémiologiques, l'analyse de banques de dossiers, et l'étude des registres des compagnies d'assurances. Seules les études épidémiologiques peuvent donner des indications sur la fréquence des complications observées, les deux autres sources ne permettant qu'un classement des accidents déclarés.
Études épidémiologiques
Ne seront retenus ici que les résultats de quatre études prospectives publiées au cours de ces 10 dernières années :
Cohen et al, 1986 [26] : 198 000 anesthésies réalisées dans un hôpital universitaire avec observation des patients sur toute la durée de l'hospitalisation, recueil de toutes les complications ; Tiret et al [135] (enquête Inserm) : 198 103 anesthésies réalisées dans des structures privées et publiques, avec observation des patients durant l'anesthésie et les premières 24 heures de l'hospitalisation, recueil des complications majeures qui sont classées en fonction de leur dépendance avec l'anesthésie ; Cohen et al, 1992 [25] : 27 184 anesthésies réalisées dans un hôpital universitaire avec observation des patients durant toute la durée de l'hospitalisation, recueil des complications majeures et mineures avec distinction de celles qui sont liées à l'anesthésie ; Moller et al, 1993 [95] : 20 800 anesthésies réalisées dans différentes structures avec observation durant toute l'hospitalisation et recueil des complications mineures et majeures liées à l'anesthésie.
Études de banques de données
Ce type d'étude n'apporte pas d'information précise au plan épidémiologique, car dépourvu de dénominateur (nombre d'anesthésies réalisées) et doté d'un numérateur (complications) souvent inférieur à la réalité. Il permet cependant d'identifier les complications prépondérantes, de favoriser, de par l'accumulation des dossiers, l'approche de facteurs responsables et de définir les règles de sécurité. C'est ainsi qu'à travers trois études rassemblant 3 200 dossiers de complications et conduites soit aux États-Unis [29], soit en Suède [141], soit en Australie [143], on peut faire les remarques suivantes : dans 80 % des cas, l'accident aurait pu être évité [143] ; une grande majorité des complications est due à l'erreur humaine (et en particulier à un défaut de surveillance), et seulement dans 4 % des cas à un défaut de l'appareillage [29] ; l'altération préalable du l'état général aggrave fortement les conséquences de la complication [29] ; les complications identifiées sont toujours les mêmes depuis des décennies [29, 141].
On peut aussi par sélection de dossiers essayer de répondre à des interrogations. C'est ainsi que sur 96 complications comportant, au cours de l'anesthésie, un changement de praticien, il a pu être démontré que si dans 11 % des cas le remplacement était responsable de l'accident, dans 31 % des cas, il avait permis de détecter rapidement la complication en cours. Cette étude a pu rendre licite le remplacement d'un praticien fatigué sous réserve du respect de règles très strictes qui ont fait l'objet, aux États-Unis d'une codification [28].
Litiges enregistrés par les compagnies d'assurances décès ou lésions cérébrales irréversibles (50 %) et 751 autres complications dont la responsabilité incombait à l'anesthésie [138].
Dans une étude plus récente portant sur 150 dossiers de complications considérées comme sérieuses survenues de 1989 à 1990 en Angleterre, Aitkenhead dénombre 40,8 % de lésions cérébrales et médullaires et de décès per- et postopératoires, 12,2 % d'éveils peropératoires, 7,5 % de douleurs au cours des anesthésies régionales (AR), 4,1 % d'atteintes nerveuses périphériques et 23,9 % de complications diverses [3]. Aux États-Unis, 23 compagnies d'assurances ont accepté de communiquer à un groupe d'experts de l'American society of anesthesiology, 2.046 dossiers de complications anesthésiques enregistrés de 1974 à 1987 et analysés sous la dénomination d'ASA closed claims study (série ASA). Le tableau XII rapporte les données générales du matériel étudié en présentant les complications, d'une part, en fonction de leur expression clinique et, d'autre part, en fonction de leur mécanisme d'apparition, c'està- dire de leur cause. Cette façon de procéder est heureuse car, jusqu'à cette date, les deux présentations étaient habituellement mélangées. Les traumatismes dentaires ont été exclus de l'étude. Les décès et les encéphalopathies anoxiques constituaient 47 % des cas, suivis par les lésions nerveuses.
Au plan du mécanisme d'apparition, les accidents d'origine respiratoire avaient représenté plus d'un tiers des cas et les accidents d'origine circulatoire 6 % [21]. De cette enquête sont également issues plusieurs études focalisées sur différentes familles de complications [17, 18, 20, 21, 56, 76]. Elles seront évoquées ailleurs dans ce texte. En France, le groupe des assurances mutuelles médicales (GAMM) a, en 1995, enregistré 191 déclarations mettant en cause la responsabilité de l'anesthésie. Le tableau XIII donne la répartition de ces complications.
Comme dans bien d'autres études, ont été mélangés la définition de la complication, son mécanisme et son cadre (anesthésie générale ou régionale). Les traumatismes dentaires étaient les plus fréquents (46 %). La mortalité était de 15 % et le taux des séquelles graves de 22 %. Il ne paraît pas possible de faire une synthèse ou d'établir des comparaisons à partir, ou entre, ces études dont les présentations sont différentes. On retiendra cependant la haute fréquence des plaintes pour traumatisme dentaire (de l'ordre de 50 %), et lésions nerveuses périphériques (de l'ordre de 4 % en Europe et de 5 % aux États-Unis). Le nombre des déclarations de décès ou de lésions cérébrales irréversibles s'étend de 50 % au Royaume-Uni à 47 % aux États-Unis (hors prise en compte des traumatismes dentaires) ; en France (horsencéphalopathies irréversibles), il est de 15 %.
Épidémiologie analytique
Après avoir estimé la fréquence des complications, il convient d'estimer le mécanisme qui est à l'origine de la complication, afin d'en dégager les facteurs. Cet exercice est périlleux en raison du mélange fait, dans la plupart des études, entre complication (symptôme) et mécanisme, la seule étude ayant nettement distingué symptôme et mécanisme étant l'étude ASA. On insistera en particulier sur les complications respiratoires et circulatoires qui constituent les causes principales de mortalité et de morbidité.
Complications respiratoires
La fréquence des complications respiratoires en salle d'opérations et durant le réveil estcomprise entre 0,04 % dans l'enquête Inserm (mais il ne s'agit ici que de complications majeures) et 15,2 % dans l'étude de Moller et al (tableau X), mais sont prises en compte ici les hypoxémies détectées dans la moitié de l'effectif par la mesure de la SpO2 [99]. Dans leur étude de 1992, Cohen et al en retiennent 4 % (tableau IX) [25]. En postopératoire, les valeurs rapportées sont de 2,3 % [25] et 3,5 % [95]. Dans la majorité des études, un accident d'ordre respiratoire ou un mécanisme d'ordre respiratoire était à l'origine des complications observées : 34 % des cas dans la série ASA et 32 % des cas dans la série Inserm. Ces complications ou ces mécanismes étaient responsables de plus de 85 % des décès et atteintes cérébrales irréversibles observés : dans la plupart des cas, l'accident aurait pu être évité [36]. Le tableau XII rapporte les six principaux mécanismes respiratoires à l'origine des complications retenues dans la série ASA [21].
Les hypoventilations représentent, dans ces deux dernières études, la première cause des complications respiratoires, 28 et 31 % respectivement. Dans la série Inserm, il s'agissait de dépressions respiratoires observées dans 70 % des cas dans les premières heures postopératoires. Dans la série ASA, il s'agissait d'un mécanisme de complication mis en cause, dans la plupart des cas, au cours de l'anesthésie et à l'origine d'hypoxémie et d'hypercapnie, en relation avec des volumes courants ou des fréquences respiratoires inadaptés. Les auteurs américains font référence à des prestations anesthésiques réalisées parfois par un personnel non qualifié. Les auteurs français notent, qu'à l'époque où les accidents ont été relevés, de nombreux centres n'étaient pas encore équipés de salle postinterventionnelle. On peut ajouter aussi que la préférence allait aux anesthésies dites analgésiques réalisées avec de hautes doses de morphiniques. En peranesthésique et en salle postinterventionnelle, Moller et al (tableau X) relèvent un taux d'hypoventilations de 2,1 %. En postopératoire, les hypoventilations peuvent également survenir lors de perfusions intraveineuses mal contrôlées de morphiniques, ou avec leur administration en péridurale ou rachianesthésie [100, 108] (cf infra).
Les inhalations de liquide gastrique sont rapportées avec une fréquence de 0,06 % [25], 0,1 % [95], 1,1 % dans l'enquête Inserm dont 22 % à l'induction. Elles représentent, dans cette étude, 30 % des complications respiratoires totalement liées à l'anesthésie. Dans les collectifs de complications, les valeurs sont : 7 % dans la série ASA [21], 14 % dans la série MDU [138] et 4,4 % dans la série australienne [143]. Dans la série ASA, l'inhalation (5 % des mécanismes respiratoires) survenait dans 34 % des cas au cours de l'induction, avant l'intubation trachéale, dans 41 % des cas au cours d'une anesthésie avec masque facial, et dans 18 % des cas au cours du réveil [21]. À l'induction, ces accidents se rencontraient principalement au cours des séquences d'induction rapide. Les difficultés liées au maintien de la liberté des voies aériennes (changement de sonde d'intubation, par exemple) exposent également aux inhalations [110]. Dans la série ASA, 50 % des patients ayant inhalé sont décédés, ou ont eu des lésions cérébrales irréversibles, contre 22 % dans la série française.
Les difficultés liées à l'intubation trachéale se rencontrent dans 0,9 % [25] et 1,5 % [95] des cas. Dans l'étude ASA, hors intubation oesophagienne, les difficultés de l'intubation représentent 17 % des mécanismes des complications respiratoires, et 6 % du total des mécanismes retenus (tableau XII). Ces difficultés étaient responsables de traumatisme des voies aériennes, et de décès ou de lésions cérébrales irréversibles (56 % des cas).
Dans 36 % des cas seulement, un meilleur monitorage aurait diminué les conséquences de l'acte contre 90 % pour l'intubation oesophagienne et la ventilation inadéquate [17].
Les intubations oesophagiennes sont notées, chez Moller et al, à la fréquence de 0,33 % (tableau X). Dans l'étude ASA, elles représentent 15 % des mécanismes des complications respiratoires (tableau XII).
Dans 48 % des cas, un contrôle par l'auscultation avait permis de conclure à une bonne mise en place de la sonde dans la trachée.Dans 60 % des cas, des troubles cardiocirculatoires, et dans 34 % des cas, une cyanose avaient précédé le diagnostic. Des décès ou lésions cérébrales irréversibles étaient apparus dans plus de 90 % de ces cas [21].
Les obstructions des voies aériennes ont été relevées dans 0,7 % des anesthésies [95] et représentent 7 % des mécanismes respiratoires des complications dans la série ASA. Dans cette série, 70 % des obstructions avaient une localisation haute : spasme laryngé (28 %), polype, oedème, hématome laryngé ou présence de corps étranger (7 %), la cause n'ayant pas pu être identifiée dans 35 % des cas. Dans 30 % des cas, l'obstruction avait une localisation basse : obstacle interne ou compression de la trachée ou des bronches (21 %), obstruction du tube endotrachéal (9 %). Ces accidents ont expliqué 64 % des décès et 23 % des lésions cérébrales de cette série. Dans l'enquête Inserm, l'item obstruction des voies aériennes n'apparaît pas. Trois laryngospasmes étaient survenus au cours de l'entretien de l'anesthésie sans occasionner de décès.
Les bronchospasmes ont été décrits avec une fréquence de 0,004 % [21], 0,5 % [26] et 0,9 % [95].
Ils représentaient, dans la série ASA, 5 % des mécanismes des complications d'origine respiratoire [21]. Ils étaient rencontrés à tous les temps de l'anesthésie mais dans 80 % des cas au cours de l'induction [96]. Dans 50 % des cas ce type d'accident était apparu chez un patient asthmatique ou insuffisant respiratoire de type obstructif à l'occasion de l'intubation trachéale [21]. Le risque de bronchospasme est particulièrement important en obstétrique (20 % des cas de la série ASA) ; la réduction des doses pour sécuriser le foetus en est probablement responsable dans la plupart des cas. On ne relève, dans la série Inserm, aucun décès ou lésions cérébrales en relation avec un bronchospasme alors que, dans la série ASA, 28 des cas de bronchospasmes (77 %) sont décédés. Ces divergences sont dues à la différence de méthodologie des études. Le traumatisme des voies aériennes est une complication séquellaire (et non un mécanisme) d'un événement survenu au cours de l'anesthésie. Dans la plupart des études, cette complication est classée sous différentes rubriques. Elle représente 5 % des complications totales retenues dans l'étude ASA (tableau XII). Les lésions intéressaient principalement le larynx, le pharnyx et l'oesophage (avec médiastinite) mais aussi le nez, l'articulation temporomaxillaire, la bouche, les lèvres, les gencives, la trachée. Les plus fréquentes étaient une paralysie des cordes vocales, une dislocation aryténoïdienne ou l'apparition d'un granulome. Dans 42 % des cas, elles étaient consécutives à une intubation difficile, dans les 58 % restants, on notait, entre autre, l'insertion d'une sonde gastrique, d'un tube nasopharyngé ou d'une canule buccale. Aucun facteur de prédisposition lié aux patients n'a été mis en évidence. Dans 12 % des cas, ce type de complication a conduit au décès [21]. Dans l'étude Inserm, le terme " traumatisme des voies aériennes " n'est pas avancé, mais on relève 10 % de complications de l'intubation trachéale avec 12 % de décès ou de lésions cérébrales irréversibles (tableau VIII).
Les pneumothorax sont recensés à la fréquence de 0,1 % dans l'enquête Inserm (2,2 % des complications respiratoires). Dans les collectifs de dossiers, on en relève 0,85 % [143], 1,3 % [134], et 3 % [21]. Dans la série ASA, le pneumothorax est considéré comme une complication et non une cause de complication. Dans 40 % des cas, cet accident était en relation avec la réalisation d'un bloc au cours d'une anesthésie régionale (cf infra), dans 19 % avec un incident de technique respiratoire (laryngoscopie, mise en place de la sonde trachéale, bronchoscopie), dans 16 % avec un barotraumatisme lié au blocage de la valve expiratoire du circuit ou à un volume courant trop important, dans 7 % à la mise en place d'une voie veineuse centrale et dans 9 % avec diverses causes (bronchospasme, embolie gazeuse). Dans les incidents de manipulation respiratoire et les barotraumatismes, la mortalité et les lésions cérébrales irréversibles ont été de 67 %, alors qu'il n'y a eu aucune issue sévère après la réalisation d'un bloc ou la mise en place d'un cathéter central. Les soins apportés aux patients avaient été jugés comme corrects dans 56 % des pneumothorax liés aux blocs ou à la mise en place des cathéters centraux, et seulement dans 8 % des cas où le pneumothorax était lié aux manoeuvres respiratoires. En effet, le pneumothorax est un risque reconnu des blocs nerveux ou de la mise en place des cathéters centraux alors qu'il n'en est pas de même dans les autres éventualités.
Les incidents liés à une défaillance de l'équipement ont été notés dans 0,002 % [135] et 0,3 % des anesthésies [25]. Ils représentent 5 % des accidents respiratoires dans l'enquête Inserm. Dans la série ASA, où ils sont considérés comme un mécanisme responsable de complications, ils apparaissent au taux de 9 %. On les rencontre de préférence au cours de l'anesthésie et en particulier lors de l'induction. Bien étudiés par Cooper et al [29], ils sont en relation principalement avec le débranchement d'un tuyau, une fuite importante de gaz, un dysfonctionnement de la mécanique de l'appareil ou des débitmètres (en particulier des rotamètres). L'inversion des admissions d'oxygène et de protoxyde d'azote a été également signalée. Ces accidents, qui étaient responsables en France en 1986 de 15 à 20 décès par an [35], sont prévenus par la mise en place de dispositifs de sécurité (O2-N2O), et par la vérification du matériel avant l'anesthésie devenue également obligatoire en France (arrêté du 30 octobre 1995). Le monitorage de la SpO2 est particulièrement performant dans la détection de ce type d'accident.
Parmi les autres complications, la survenue d'atélectasies en postopératoire (0,7 %) est reconnue comme dépendante de l'anesthésie [95]. Les pneumopathies ont un taux de 1,6 % [95]. Dans les complications mineures, les maux de gorge tiennent une place importante puisque 14 % des patients interrogés à la sortie d'un hôpital se plaignaient de cette complication [43].
Une large place a été faite ici à l'étude des complications respiratoires parce qu'elles sont responsables de la très grande majorité des issues fatales. La plupart des auteurs considèrent qu'une grande partie de ces accidents est due à des fautes. Dans la série ASA, on admet que 72 % de ces accidents, ou plutôt de leurs conséquences, auraient été prévenus par un meilleur monitorage, alors que seulement 11 % des complications ne relevant pas d'un mécanisme respiratoire auraient pu être évités par un meilleur monitorage. Ces valeurs sont peut-être excessives, dans la mesure où un biais important réside dans l'évaluation de la qualité des soins administrés lors de l'accident en relation avec la connaissance qu'ont les experts, des conséquences de l'accident [37].
Complications cardiovasculaires
L'enquête Inserm faisait état de 0,08 % de complications cardiovasculaires sévères au cours de l'anesthésie et des premières heures postopératoires. Plus récemment, et en périopératoire, on en a relevé 12,6 % [95] et 6,3 % [115]. Mais la définition de ce risque prête à discussion car interfèrent de nombreux incidents, symptômes d'un événement ou la complication cardiovasculaire comme augmentant la mortalité, entraînant des séquelles, prolongeant la durée de l'hospitalisation ou produisant un surcoût dans la prise en charge du patient, certaines rubriques classiques dans l'étude de ces complications n'apparaîtraient pas. Il en est ainsi des perturbations de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque, et des troubles du rythme. Pourtant, ces anomalies peuvent être à l'origine d'authentiques complications, et il paraît utile, dans le cadre de la recherche de stratégies, de pouvoir apprécier leur prévalence. Le tableau XIV rapporte les principales données épidémiologiques, recueillies sur des populations non sélectionnées, se rapportant à ces complications.L'infarctus du myocarde (IDM) est cité dans la plupart des séries avec une fréquence inférieure à 1 %. Il est le plus souvent diagnostiqué en postopératoire, particulièrement au cours du premier mois. Sa prévalence est de l'ordre de 5 à 8 % s'il existe un antécédent de nécrose [91]. L'incidence est plus élevée si la nécrose est récente : 37 % avant 3 mois, de 16 à 30 % entre 3 et 6 mois, 3 % au-delà de 6 mois. Un antécédent de chirurgie vasculaire élève le risque de 1 à 15 % [91, 132]. Outre l'existence d'un IDM antérieur, les facteurs de risque d'IDM périopératoire (dont la mortalité oscille, selon les études, de 36 à 70 %) [91] sont : l'existence d'une altération de la circulation coronaire, d'une insuffisance ventriculaire gauche, d'une hypotension artérielle peropératoire [93]. Chez les patients ayant eu un IDM depuis moins de 6 mois le risque a pu être abaissé à 5 % au prix d'un monitorage invasif associé à un traitement agressif des anomalies hémodynamiques périopératoires jusqu'au cinquième jour [120].
L'administration d'un bêtabloquant en préet postopératoire a, dans une étude de 1996, réduit l'incidence de l'IDM d'une population à risque coronarien, hors chirurgie cardiaque, à 0 % (versus 8 %) au cours du premier mois, 3 % (versus 14 %) à la fin de la première année, et 10 % (versus 21 %) au bout de 2 ans [92].L'ischémie myocardique, expression de la maladie coronaire, peut entraîner par sa répétition un trouble de la compliance du ventricule gauche, une altération de l'éjection cardiaque et des troubles du rythme ventriculaire. Elle traduit soit une insuffisance d'apport, soit une augmentation de la demande en O2 du myocarde liée à une tachycardie, une hypertension, une anémie, un stress, l'administration d'un sympathomimétique ou l'arrêt d'un traitement bêtabloquant. Sa prévalence est faible dans les grandes séries (tableau XIV) en raison de la difficulté de son diagnostic. Selon Mangano, son incidence est de 24 % en préopératoire, de 18 à 74 % en peropératoire et de 27 à 38 % en postopératoire [91]. L'insuffisance ventriculaire gauche est la conséquence d'une ischémie, d'un IDM ou de la décompensation d'une cardiopathie ischémique. Elle n'apparaît pas dans le tableau XIV car faiblement documentée dans les grandes séries. Pedersen et al [115] en relèvent, cependant en 1990, en periopératoire 1,8 % (choc cardiogénique et oedème aigu pulmonaire) et Forest et al 0,4 % [51].
L'insuffisance cardiaque congestive, bien que rarement citée, apparaît dans les études récentes au taux de 0,3 % dans une série non sélectionnée [115] et de 3,6 % chez une population de plus de 40 ans [58]. Il s'agissait, dans la plupart des cas, de la décompensation d'une insuffisance cardiaque congestive connue ou méconnue provoquée par l'effet inotrope négatif des agents anesthésiques, une hypovolémie, des troubles du rythme, la perte de la systole auriculaire, l'augmentation de la postcharge, ou une augmentation brutale de la Vo2 (frisson). Elle se traduisait soit par un collapsus (voire, un arrêt circulatoire), reflet d'un bas débit cardiaque, soit par un oedème pulmonaire secondaire à la majoration de la congestion en amont du ventricule gauche, souvent favorisée par un remplissage excessif. Les troubles du rythme sont mentionnés dans de nombreuses études. Le tableau XIV objective la dispersion des valeurs observées (0,9à4,8 %). Forest et al avaient relevé, en 1990, pour la période périopératoire : arythmies atriales (0,2 %), ventriculaires (0,6 %) et nodales (0,1 %) ; ces deux derniers modes étaient favorisés par l'halothane [50]. Il s'agit en général d'un événement banal, plus fréquent quand il existe une pathologie cardiaque préexistante. Il peut cependant devenir grave s'il s'accompagne de tachycardie, ou s'il évolue vers une fibrillation ventriculaire.
Les modifications de la fréquence cardiaque, symptômes et non complications, sont bien documentées. On notera, sur le tableau XIV que la fréquence des bradycardies varie avec les études. Pour une valeur inférieure à 40 b·min-1, son taux est de 0,4 % en peropératoire, en relation avec des effets pharmacodynamiques [50]. Il en est de même pour les tachycardies qui, pour une fréquence supérieure à 140 b·min-1, sont inférieures à 1 % [50]. Signe accompagnateur de l'hypovolémie et de l'ischémie myocardique, souvent associées à l'hypotension, la tachycardie est un bon signal d'alarme.
L'hypotension artérielle a une fréquence qui varie avec le seuil retenu (tableau XIV). À l'induction elle peut être révélatrice d'un accident allergique ou d'un surdosage. Au cours de l'entretien elle témoigne d'une hypovolémie ou d'une souffrance myocardique.
L'hypertendu artériel est particulièrement exposé à ce type de complication ; chez celui-ci, si la pression artérielle baisse de plus de 50 % par rapport aux données basales, ou de plus de 33 % pendant plus de 10 minutes, il existe une augmentation significative du risque opératoire [57].
L'hypertension artérielle (accès hypertensifs) répond aux mêmes critères de non homogénéité. Sévère, elle n'excède pas 1 % dans la période périopératoire [50].
Complication de l'anesthésie de l'hypertendu, elle expose au déclenchement d'une ischémie myocardique, chez les insuffisants coronariens, et/ou à la décompensation d'une insuffisance ventriculaire gauche. Son incidence dépend de la qualité du traitement préopératoire et du type de l'acte chirurgical [57].
Complications neurologiques
Très invalidant, ce type de complications donne fréquemment lieu à des recours médicolégaux.
On distingue des complications centrales, médullaires et périphériques.
On peut y associer les complications psychologiques (souvent appelées de stress), essentiellement liées à la mémorisation d'éveils peropératoires. Les complications dites médullaires seront examinées ultérieurement.
Complications centrales
Elles comprennent les troubles de la conscience et les accidents vasculaires cérébraux. Les troubles de la conscience, pour la plupart d'origine hypoxémique, ont pour expression majeure les comas dont la fréquence est comprise entre 0,6 % [95] (tableau X) et 0,008 % dont 0,005 % totalement dépendant de l'anesthésie [135] (tableau VII). En ce qui concerne les banques de données et les compagnies d'assurances, leur fréquence est de l'ordre de 11 % [138] et 12 % [21] (tableau XIII). La complication est révélée en postopératoire, mais l'accident qui en est à l'origine peut se produire soit durant l'anesthésie, soit au cours du réveil ; il est lié à une diminution de la concentration d'oxygène inspiré (cause respiratoire) ou à une mauvaise distribution tissulaire de l'oxygène (cause circulatoire). Les causes respiratoires sont les plus nombreuses et ont été commentées (cf supra). Dans l'enquête Inserm, sur les dix comas observés, totalement dépendants de l'anesthésie, cinq d'entre eux étaient en relation avec une dépression respiratoire postanesthésique. Une mauvaise distribution d'oxygène aux tissus et donc au cerveau relève, au cours ou au décours de l'anesthésie, d'une diminution du débit cardiaque, due fréquemment à l'effet inotrope négatif d'un grand nombre d'agents anesthésiques, dont les anesthésiques locaux, de troubles du rythme ou de la fréquence cardiaque, d'un arrêt cardiaque, d'une hypotension artérielle pathologique ou thérapeutique, d'une grave anémie, d'une embolie gazeuse. Les complications peuvent se limiter à des somnolences prolongées (0,6 %) en salle postinterventionnelle [95] ou des confusions en postopératoire 0,6 % [25] (tableaux IX et X). Les séquelles peuvent aller de simples troubles psychologiques à l'état végétatif.
Les accidents vasculaires cérébraux ont été diagnostiqués en postopératoire à la fréquence de 0,6 % [25] et 0,006 % [135]. La série ASA en retient 3 % [21]. Ces complications se rencontrent chez des patients âgés, et la responsabilité de l'anesthésie dans leur survenue est discutable. Mais ils paraissent favorisés par des variations tensionnelles peropératoires importantes ou des troubles du rythme [64].
Complications périphériques
Elles sont essentiellement le résultat de la compression ou de l'étirement d'un nerf entraînant des paresthésies et/ou une paralysie, accidents bien étudiés ailleurs dans ce traité [38]. Exceptionnellement, la lésion nerveuse peut être en relation avec un traumatisme direct par une aiguille ou l'extravasation d'un médicament. Ce type d'accident est très documenté dans les différentes études, avec cependant quelques difficultés compagnies d'assurances, on relève des taux de 4,3 % [138] et 6 % (GAMM 1995) (tableau XIII). Dans la série ASA, la fréquence était de 15 % dont 39 % liés à une ALR. Dans cette étude, une lésion du nerf cubital était identifiée dans 34 % des accidents neurologiques, une atteinte du plexus brachial dans 23 % et des racines lombosacrées dans 16 % [76]. Dans certains cas, le mécanisme de la lésion n'était pas évident. Souvent le patient accusait déjà avant l'anesthésie, dans certaines positions, des douleurs dans le territoire incriminé. De plus, en particulier dans les atteintes du nerf cubital, il est arrivé qu'on découvre, lors d'examens électrophysiologiques, des anomalies sur le nerf controlatéral. Les neuropathies préexistantes constituent également un facteur de risque.
La responsabilité de ces accidents met en cause fréquemment chirurgien et anesthésiste.
Les lésions sont de type démyélinisation localisée au point de compression. Dans la plupart des cas, la remyélinisation intervient en 6 à 8 semaines ; mais elle peut être plus tardive et, dans de rares cas, la lésion est définitive.
Complications psychologiques
Elles sont de l'ordre de 1,5 % [25] et incluent le plus souvent les mémorisations des périodes d'éveil (awareness), survenues en peropératoire qui sont, elles, fréquemment citées. Elles traduisent le stress lié à l'opération et à l'anesthésie. Une étude de 1996 fait le point sur ces mémorisations, dont la fréquence est très variable en raison des critères diagnostiques adoptés pour les définir, en particulier si l'on tient compte des rêves dont fait part le patient à son réveil, surtout si c'est un psychologue qui les recherche [65]. Les incontestables mémorisations de périodes d'éveil durant la phase opératoire ont une fréquence de l'ordre de 0,20 % [26, 83]. Mais celles-ci sont plus importantes en anesthésie obstétricale : 0,6 % [88] et en chirurgie cardiaque où, dans certaines études, on en recense de 1 à 23 % [60, 117]. Dans les dossiers de banques de données et de compagnies d'assurances, on note un taux de 23,2 % sur les 69 complications totalement dépendantes de l'anesthésie dans la série australienne [143], de 3,7 % sur les 1 501 dossiers de la MDU [143] et de 3 % sur 1960 dossiers de la série ASA [21].
Cet accident résulte d'une concentration insuffisante d'agent hypnotique ou anesthésique chez un patient curarisé qui, conscient, a la perception de son environnement, souffre (et ce d'autant plus qu'il a été sous-dosé en analgésique), alors qu'il est paralysé et ne peut donc pas manifester. Il a été démontré que les patients ayant subi cette situation de stress développent, pour 66 % d'entre eux, des troubles psychologiques graves. La prise de conscience de cette complication (classée dans les majeures), et les conséquences médico-légales à l'encontre des anesthésistes responsables, en ont probablement réduit la fréquence. Elle était cependant encore signalée en 1991 avec une fréquence de 0,9 % en anesthésie non obstétricale [83] et de 3,3 % en 1995 en chirurgie cardiaque [98]. Cette complication est peu connue en France ; elle n'apparaissait pas dans l'étude Inserm mais deux déclarations en ont été faites auprès du GAMM en 1995 (tableau XIII).
Complications diverses
Complications anaphylactiques et anaphylactoïdes
Faisant l'objet d'une mise au point dans ce traité [78], on se limitera ici à souligner leur actualité en relation avec l'augmentation du nombre des agents de l'anesthésie qui ont pour la plupart, à des degrés divers, un risque potentiel histaminolibérateur ou allergisant à symptomatologie cardiocirculatoire ou respiratoire. Ce risque a été évalué par l'enquête Inserm à un choc grave pour 4 600 anesthésies, avec 6 % de mortalité [135]. Il a été estimé 0,02 % en Australie en 1984 [50] et en France en 1993 [79]. Dans l'Australian incident monitoring study, 57 des 2 000 accidents rapportés étaient en relation avec des réactions de type anaphylactique ; parmi celles-ci 33 réactions étaient classées comme modérées et 17 comme sévères [31].
Hyperthermie maligne
Elle est presque absente des grandes études épidémiologiques, en raison de sa rareté et de sa localisation géographique variable. Cependant Cohen et al, en rapportent deux cas paraît pas engagée que les dossiers d'assurances n'en font pas état. Les estimations situent sa fréquence entre 1/14 000 et 1/40 000 anesthésies, mais la forme fulminante ne se rencontrerait que dans 1/250 000 anesthésies. Pour plus de détails sur cet accident redoutable, le lecteur est invité à se reporter à l'étude qui en est faite dans ce traité [75].
Hépatite aiguë
Elle ne concerne au plan épidémiologique que l'halothane. Sa fréquence est évaluée de 1/10 000 à 1/30 000 anesthésies [131, 44]. Cohen et al signalent, en 1986, 0,01 % de complications hépatiques [26]. Sur une série de 62 cas sélectionnés par le Comitee of safety of medecine, aux États-Unis, 41 patients avaient reçu de l'halothane plus d'une fois, d'où le rôle retenu de la répétition de l'administration [3]. Les autres anesthésiques par inhalation, de métabolisme hépatique moins important que l'halothane, semblent présenter une toxicité hépatique moindre.
Traumatisme dentaires
Ils représentent 1,2 % des plaintes des patients interrogés en fin d'hospitalisation [44]. Les enquêtes épidémiologiques en relèvent 0,095 % [26] et 0,17 % [25]. Une étude centrée sur ce sujet en retenait en 1986, 0,1 % [87]. Cet accident est donc rare. Mais dans les dossiers des banques de données ou des compagnies d'assurances, cette complication arrive largement en tête : 20,6 % [143], 52 % [138] et 46 % dans les déclarations en France auprès du GAMM en 1995 (tableau XIII). Une intubation difficile ou en urgence est responsable de la moitié des traumatismes, dont 25 % se produisent à l'extubation ou en salle postinterventionnelle. C'est l'incisive supérieure gauche qui est le plus souvent lésée [84]. Dans 62 % des cas, le traumatisme intéresse une ou des dents antérieurement traitées ou siège d'une périostite alvéolodentaire [15]. Une étude de 1989 a montré que 55 % des traumatismes dentaires étaient en relation avec la mise en place d'une canule buccale et non avec la laryngoscopie [24].
Nausées et vomissements postopératoires
Ils ont considérablement diminué avec le temps et en fonction du mode d'anesthésie utilisé. On notera sur le tableau XV que l'incidence de cette complication, notée avec les différents anesthésiques halogénés, est homogène et qu'elle est nettement plus marquée avec l'utilisation du fentanyl. D'autres facteurs peuvent en modifier la fréquence. C'est ainsi que l'utilisation de néostigmine comme antidote des curares élève le taux de nausées et de vomissements postopératoires de 11 à 47 % [73]. Parmi les anesthésies veineuses c'est avec la neuroleptanalgésie et l'anesthésie au propofol [103] que l'incidence de cette complication est la plus basse. Les anesthésies rachidiennes sont également génératrices de nausées et vomissements en relation avec l'hypotension artérielle. Ces complications sont classées parmi les mineures, bien que quelques cas prennent place en raison de leur intensité parmi les majeures [50]. Elles restent cependant un problème fondamental en anesthésie ambulatoire.
Lésions oculaires
Elles ont été signalées dans 0,06 % des anesthésies [26]. À la sortie de l'hôpital 0,6 % des patients interrogés se plaignaient des yeux [43]. Dans les collectifs de données, cette complication est citée avec une fréquence de 3 à 4 % [3]. Dans la série ASA, une ulcération cornéenne était intervenue dans 3 % des litiges. Elle résultait, entre autres, du contact de la cornée avec un agent irritant, ou d'un traumatisme à partir d'un masque facial, d'un laryngoscope ou d'un champ chirurgical ; dans 16 % de ces cas, la lésion avait entraîné une cécité. Dans 30 % des cas, elle était en relation avec un mouvement intempestif survenu lors d'une chirurgie ophtalmologique et s'était également accompagnée de cécité. Les experts ont considéré que, dans 81 % des cas, l'accident aurait pu être évité [57].
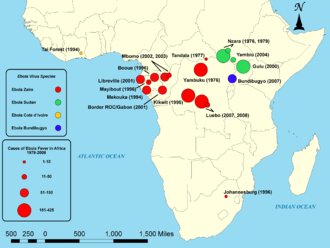


 Fukushima
Fukushima
 HOSPITALISATION A DOMICILE / TAYSIR ASSISTA
HOSPITALISATION A DOMICILE / TAYSIR ASSISTA










